Classée depuis 1976, la réserve naturelle nationale de la mare de Vauville se situe à l’extrême nord-ouest du Cotentin, au sein du site Natura 2000 du « massif dunaire de Héauville à Vauville » qui couvre près de 700 hectares. La réserve naturelle constitue un site naturel et paysager exceptionnel et se distingue du reste du massif dunaire par sa grande mare d’eau douce de près de 9 hectares, accueillant 12 des 18 espèces d’amphibiens normandes, dont le triton crêté, espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Européenne Habitat Faune Flore et classée comme vulnérable sur la liste rouge normande. En outre, la mare de Vauville présente donc un intérêt régional et national en termes de conservation des populations d’amphibiens.

Depuis 2019, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) Normand travaille sur le changement climatique et ses conséquences à l’échelle régionale : recul du trait de côte, augmentation des phénomènes de submersion, de la fréquence des aléas climatiques (périodes de pluies et de sécheresse plus intenses et plus longues) ou encore la progression du biseau salé dans les nappes. Le dernier rapport du GIEC normand fait état d’une hausse du niveau marin d’environ 3 mm/an et d’une élévation de 20 cm au cours du siècle.
Face au recul inexorable du littoral sous les effets conjugués de l'érosion et du changement climatique, le cinquième plan de gestion (2018-2027) de la réserve naturelle oriente les réflexions vers l’anticipation et l’adaptation des actions de gestion face aux conséquences du changement climatique et à une inévitable intrusion d’eau de mer dans les années à venir, menaçant la pérennité de la mare d’eau douce, de la roselière et particulièrement de la diversité d’amphibiens qui s’y reproduisent.
En 2021, afin d’anticiper au plus vite ces effets et ainsi mieux adapter les mesures de gestion au repli des espèces et aux changements à venir, , le Groupe ornithologique normand (GONm), gestionnaire de la réserve naturelle, a engagé le Laboratoire de Géographie Physique (LGP) : environnements quaternaires et actuels (UMR 8591 CNRS), afin d’effectuer une étude géomorphologique de l’ensemble du massif dunaire.
Localisé particulièrement au sud de la réserve naturelle, ce programme de recherche avait d’une part pour objectif de compléter les connaissances déjà acquises sur la structure du massif dunaire, afin notamment de mieux comprendre la composition du massif dunaire et la relation entre les sables et les formations sous-jacentes. D’autre part, ce programme visait à l’identification des nappes souterraines, au niveau d’une zone déprimée où s’observent de nombreuses zones humides qui pourraient être liées à la présence d’une nappe d’eau peu profonde, contenue dans des sables peu épais et reposant sur un substrat peu imperméable.
Pour ce faire plusieurs techniques d’exploration géophysique ont été déployées, basée à la fois sur des mesures de résistivité du sous-sol (ERT), mais également sur des prospections géoradar.
En parallèle, dans le cadre d’un stage de Master, une cartographie géomorphologique (formations et modelés) de l’ensemble du massif dunaire, de l’érosion, des formes d’érosion et des grandes unités écologiques (dune mobile, fixée…), ainsi qu’une étude géo-historique et diachronique de l’érosion (recul du trait de côte et érosion dunaire), de la végétation et de l’occupation/usage du massif dunaire ont été réalisées.
En 2024, de nouvelles prospections ont été réalisées par la plateforme D2T (Drone, Terrain, Télédétection) de l’UMR Littoral – Environnement – Télédétection – Géomatique de l’Université de Rennes spécialisée dans l’acquisition de données par drones équipés de différents capteurs (RGB, multispectrales, thermiques et Lidar), afin notamment d’envisager la détection des zones humides internes au massif dunaire, la caractérisation des formations végétales et le suivi morphologique à moyen et long terme (érosion, accrétion).
L’étude géomorphologique souligne l’érosion du trait de côte, dont le recul est estimé à une dizaine de mètres au cours des cent dernières années, menaçant à terme les milieux humides dunaires les plus proches du littoral et particulièrement la faune et la flore qui confèrent à la réserve naturelle de la mare de Vauville son caractère unique et remarquable.
L’analyse des formes d’érosion montre l’importance des usages anthropiques sur la morphologie actuelle du massif dunaire.
Tout comme observé lors de la mise à jour de la cartographie des végétations de la réserve naturelle en 2023, l’étude diachronique et les comparaisons de photographies aériennes prises au cours du siècle, mettent en évidence une stabilisation du massif dunaire, une fermeture et une banalisation des milieux. Sur la base de ces informations, une réflexion sera engagée afin de redynamiser la dune et pérenniser les milieux dunaires à forte valeur patrimoniale.
Cette étude met également en évidence la présence de deux cordons dunaires mobiles parallèles au trait de côte. En effet, le plus proche de l’estran semble correspondre à la dune blanche bordière. Au contraire, le second ne ressemble pas aux autres modèles dunaires et semble correspondre à plusieurs dunes accumulées, semi-fixées, pouvant dater de la transgression flandrienne (remontée du niveau de la mer d'environ 100 m survenu au Pléistocène, soit entre -20 000 et -10 000 ans). Afin de connaître l’origine exacte de cette succession de cordons dunaires mobiles, de nouvelles investigations pourraient être menées, notamment à travers la datation des dunes et des analyses granulométriques et géochimiques sur les sédiments profonds, afin d’affiner les connaissances sur la chronologie de formation du massif dunaire.
L’analyse du réseau hydrologique à travers la cartographie des mares souligne l’importance des zones humides interdunaires et une répartition inégale des mares. Cela permet d’identifier à la fois un potentiel très intéressant de zones humides interdunaires dans un contexte où la menace qui pèse sur celles les plus proches du trait de côte va grandissante, mais souligne également un fonctionnement complexe. Les mesures géophysiques ont montré la présence de sable saturé en eau douce, particulièrement sur les secteurs de dune fixées, en arrière des cordons de dune blanche.
La compilation sous SIG des données qui concernent les dépressions humides (altitude, profondeur…) et des données récoltées à l’aide des sondages et par drone pourraient apporter des informations supplémentaires quant au fonctionnement hydrologique du massif et aux connexions possibles entre certaines mares dépendantes des mêmes nappes qui est un enjeu pour la politique de conservation des espèces inféodées aux zones humides.
L’ensemble des données obtenues va permettre d’alimenter la réflexion sur les mesures de gestion à mettre en place afin de densifier le réseau de mares en limite sud de la réserve et ainsi assurer la connexion des milieux humides et des espèces qui en dépendent avec les mares situées sur la commune de Biville, particulièrement pressantes au regard des menaces d’intrusion marine.
Enfin, les données obtenues au cours des sondages par drone mettent en évidence un manque de connexion entre les mares de la réserve et les mares de Biville pouvant exercer une influence sur les populations d’amphibiens et notamment en limitant leur capacité à coloniser les sites aquatiques plus au sud du massif dunaire. La densité des points d’eau est un facteur jouant un rôle important sur la répartition des tritons crêtés (Jacob et Denoël, 2007), pouvant expliquer l’absence de cette espèce sur les autres mares du massif dunaires. En effet, à l’exception d’une mare creusée en 2015 sur l’ancien terrain militaire de Vasteville, le triton crêté n’a pas été observé ailleurs que sur la réserve naturelle.
Du fait de sa mobilité réduite, (points d’eau distants de quelques centaines de mètres), le triton crêté est une espèce particulièrement sensible à la fragmentation des habitats. La création de nouveaux sites aquatiques pourrait donc être envisagée afin notamment de permettre aux espèces à faible mobilité de coloniser ces nouveaux espaces et ainsi mieux adapter les mesures de gestion au repli des espèces aquatiques en cas d’intrusion marine au sein de la réserve naturelle.
Synthèse étude géomorpho 2021-2024-VF.pdf
![]()
 Du 26 Février au 5 mars dernier, 3 adhérents du GONm ont accompagné Fabrice Gallien à Chausey pour des travaux à réaliser sur l’ilot de la Meule situé au nord-ouest de la grande ile. Nous étions accompagnés par une équipe de 4 personnes de deux entreprises de paysagistes basées dans la Manche.
Du 26 Février au 5 mars dernier, 3 adhérents du GONm ont accompagné Fabrice Gallien à Chausey pour des travaux à réaliser sur l’ilot de la Meule situé au nord-ouest de la grande ile. Nous étions accompagnés par une équipe de 4 personnes de deux entreprises de paysagistes basées dans la Manche.

















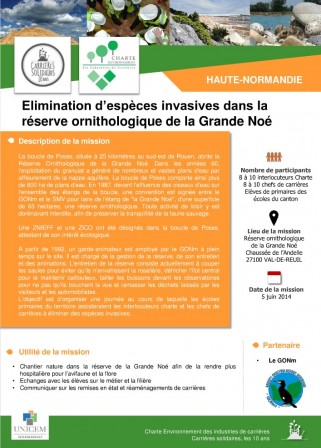
 Pour recevoir notre Newsletter : cliquez ici !
Pour recevoir notre Newsletter : cliquez ici ! Pour devenir membre du GONm : cliquez là !
Pour devenir membre du GONm : cliquez là !
 Pour acheter en ligne : c'est là !
Pour acheter en ligne : c'est là !

